Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755)
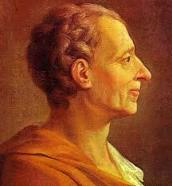
À trente ans, il publiait un ouvrage qui fit une immense sensation : les Lettres persanes. Ce livre est la critique mordante des mœurs relâchées de l'époque : l'Église, la royauté, la cour, la noblesse, y sont attaquées avec une liberté de langage qui outrage souvent le bon goût et la décence, et qui contraste avec le caractère de Montesquieu. Il est vrai qu'il eut soin de garder l'anonyme. Dès que l'on sut que l'auteur était un magistrat, le succès du livre, déjà immense, ne fit que s'accroître ; il se vendit « comme du pain, » et les libraires allaientdemandant à tous les écrivains de leur faire des Lettres persanes.
Ce succès autorisait Montesquieu à entrer à l'Académie, mais le cardinal Fleury, alors premier ministre, voulut lui en fermer les portes, à cause de la témérité des attaques des Lettres persanes. Montesquieu prit un tour adroit pour mettre le ministre dans ses intérêts : il fit faire, en peu de jours, une nouvelle édition de son ouvrage dans laquelle on retrancha ou adoucit ce qui pouvait être condamné, le porta lui-même au cardinal, et entra à l'Académie.
Après sa réception, Montesquieu comprenant que la gravité de sa place au parlement contrastait étrangement avec la légèreté de ses ouvrages, vendit sa charge et se mit à voyager pour étudier les lois et les mœurs des peuples. Il se rendit d'abord à Vienne, à la cour du prince Eugène, qui lui fit un aimable accueil. En Hongrie, il trouva encore debout le vieux système féodal ; à Venise, il rencontra l'Écossais Law, qu'il avait tant raillé dans ses Lettres persanes ; à Rome, il fut présenté au pape Benoît XIV. On raconte que lorsqu'il prit congé du pape, celui-ci, comme souvenir d'amitié, lui donna la permission de faire gras toute sa vie, lui et sa famille. Montesquieu, flatté de cette faveur, alla prendre la bulle de dispense, mais quand il vit la note un peu élevée des droits à payer, il rendit la bulle au secrétaire. « Monseigneur, lui dit-il, je remercie sa Sainteté de sa bienveillance ; mais le pape est un si honnête homme ! je m'en rapporte à sa parole. »
Il descendit ensuite le Rhin et visita la Hollande. À La Haye, il rencontra lord Chesterfield, l'un des hommes les plus éminents de l'Angleterre ; celui-ci le conduisit à Londres et le présenta à la reine, dont il gagna les faveurs par une adroite flatterie. Un jour, il avait pris le parti de l'Angleterre dans une discussion avec l'envoyé de France, qui prétendait que ce royaume n'est pas plus grand que la Guyenne. « Je sais, lui dit la reine, que vous nous avez défendus contre votre envoyé. — Madame, répondit-il, je n'ai pu m'imaginer qu'un pays où vous régnez ne fût pas un grand pays. » Il mit à profit son séjour en Angleterre, pour en étudier profondément la constitution.
Après quatre ans de voyages, Montesquieu revint en France, apportant avec lui une riche moisson d'observations et de nombreux matériaux pour les grands ouvrages qu'il méditait. Il s'ensevelit de nouveau dans sa solitude de La Brède, et après deux ans de méditations, il publia les Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains. Ce volume, qui ne contient pas plus de 200 pages, est un admirable résumé de l'histoire politique de Rome. Bossuet, dans son Histoire universelle, avait étudié la même question, mais en se plaçant à un point de vue religieux et moral ; Montesquieu l'envisage à un point de vue politique ; il fait pénétrer les lecteurs dans les détails de la vie romaine ; il leur montre le mécanisme et le jeu des institutions, leur explique la politique du sénat, et tire de cet examen des conclusions brèves et fortes.
Montesquieu travailla vingt ans à son ouvrage De L’Esprit des Lois.
Cet écrivain mérite notre admiration, non seulement par la beauté de ses ouvrages, mais aussi par la noblesse de son caractère. Il était affable, prévenant, modeste, sans suffisance ni prétention, ne faisant jamais sentir aux autres la supériorité de son génie. Enfermé dans sa solitude de La Brède, il était heureux de vivre au milieu de ses livres et de quelques amis. « Je n'ai point de chagrin, disait-il, qu'une heure de lecture ne dissipe. » « Je suis amoureux de l'amitié, ajoutait-il. » On cite de lui plusieurs traits de générosité.
Un jour, il reçoit, d'un artiste dans la misère, un billet ainsi conçu : « J'ai envie de me pendre ; mais je crois cependant que je ne me pendrais pas si j'avais cent écus. » Montesquieu lui répond aussitôt : « Je vous envoie cent écus ; ne vous pendez pas et venez me voir. »
Une autre fois, à Marseille, se promenant sur le port, il entre dans une barque pour faire une promenade dans la rade. Frappé de la maladresse du matelot, il l'interroge : le batelier répond en rougissant qu'il est joaillier de son état, et qu'il loue, le dimanche et les jours de fête, ce bateau pour gagner quelque argent : son père a été fait prisonnier par des corsaires et est esclave à Tétouan ; c'est pour gagner le prix de sa rançon que sa mère, ses deux sœurs et lui travaillent jour et nuit. Montesquieu, touché jusqu'aux larmes, s'informe du nom du père et de celui du maître à qui il appartient ; il se fait descendre à terre et, jetant sa bourse au jeune homme : « Voilà, lui dit-il, quinze louis pour qu'à l'avenir vous n'exposiez plus votre vie et celle des autres. » Puis il s'éloigne, sans laisser au jeune homme le temps de le remercier. Deux mois après, le père était rendu à sa famille et racontait qu'un libérateur inconnu l'avait racheté et lui avait même fait parvenir une somme de cinquante livres. On n'aurait jamais connu ce sauveur si, parmi les papiers de Montesquieu, on n'eût trouvé, après sa mort, une note, écrite de sa main, indiquant l'envoi d'une somme de sept mille cinq cents francs à un banquier anglais de Cadix, pour la délivrance d'un nommé Robert, esclave à Tétouan.
Montesquieu mourut à Paris en 1755, à l'âge de soixante-six ans, d'une maladie inflammatoire. On dit que les Jésuites assiégèrent son lit de mort pour lui faire rétracter les passages irréligieux des Lettres persanes ou les déclarations trop libérales de ses autres ouvrages. Montesquieu s'y refusa constamment. « J'ai toujours respecté la religion, dit-il ; la morale de l'Évangile est le plus beau présent que Dieu ait fait à l'homme. » Lorsque le curé de Saint-Sulpice, en lui donnant la communion, lui dit : « Vous comprenez combien Dieu est grand !... — Oui, Monsieur, et combien les hommes sont petits ! »
Chefs-d’œuvre de Montesquieu
Lettres persanes
L'auteur s'est proposé de présenter un tableau vif et saisissant de l'Europe et surtout de la France au XVIIIe siècle. Il suppose que deux seigneurs persans, Usbek et Rica, voyagent en France, et rendent compte à leurs amis de Perse de tout ce qu'ils y ont remarqué. Ces prétendus voyageurs raillent nos usages, nos mœurs, nos lois, les abus du gouvernement et de la société et même la religion chrétienne dont ils parlent avec une irrévérence toute musulmane. Il est difficile de se moquer avec plus d'esprit des ridicules et des vices d'une nation. Voici ce qu'écrit l'un d'eux sur la curiosité des badauds de Paris.
« Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivai, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel ; vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres -. si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre qui disaient entre eux. Il faut avouer qu'il a l'air bien Persan… Je résolus de quitter l’habit persan et d'en endosser un à l'Européenne. Je tombai tout à coup dans un néant affreux… Mais si quelqu'un disait par hasard que j'étais persan, j'entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement. Ah ! Ah ! monsieur est Persan ! C'est une chose bien extraordinaire ! Comment peut-on être Persan ! »
Nos Persans passent en revue tous les individus de la société. Ils commencent par le roi, puis viennent les courtisans, les grands seigneurs, les fermiers généraux, les magistrats ignorants, les auteurs sans talent etc. On ne saurait trop regretter que dans la peinture des mœurs de son époque, Montesquieu n'ait pas gardé plus de réserve et qu'il se soit laissé emporter loin du goût et de la décence. Mais s'il faut voiler la moitié des Lettres persanes, on doit dire que l'autre moitié est digne de l'auteur de L’Esprit des lois.
Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains.
Dans ce volume de deux cents pages, Montesquieu résume l'histoire politique du plus grand peuple de l'antiquité. Le premier, il nous a montré les Romains arrivant à l'empire de l'univers par l'égalité qui se trouve au berceau de leur histoire ; — par l'amour de la patrie et de la liberté ; — par la sévérité de la discipline militaire ; — par cette force d'âme qui, dans le malheur, ne désespéra jamais de la République ; — par le principe de ne jamais faire la paix qu'après des victoires ; — par le soin de s'approprier ce qu'ils trouvaient de bon chez les peuples étrangers ; — par cette politique habile qui laissait aux vaincus leurs dieux et leurs coutumes, qui évitait d'avoir deux puissants ennemis sur les bras, et qui souffrait tout de l'un jusqu'à ce qu'ils eussent anéanti l'autre.
Les causes de la décadence et de la chute de Rome sont :
— l'agrandissement même de l'État qui changea en
guerres civiles les tumultes populaires ;
— les guerres éloignées, qui, forçant les citoyens à une longue absence, leur faisaient perdre insensiblement l'esprit républicain ;
— le droit de bourgeoisie accordé à une foule de peuples ;
— la corruption introduite par le luxe de l'Asie ;
— les proscriptions de Sylla, qui avilirent l'esprit de la nation et la préparèrent à l'esclavage ;
— la longue suite de mauvais princes assis sur le trône impérial ;
— enfin le partage de l'empire, qui périt d'abord en Occident par l'invasion des barbares germains, et qui, après avoir langui dix siècles en Orient, se vit réduit aux faubourgs de Constantinople.
Ce livre est l'œuvre la plus complète du grand écrivain. Chaque page est un modèle de raison et de logique, un monument du grand art de composer et d'écrire. Le style est mâle, nerveux et concis. On peut regretter que l'idée de la Providence soit absente de ces Considérations.

De L’Esprit des Lois
C'est un résumé des lois de tous les peuples, « Je n'écris point, dit-il, pour censurer ce qui est établi dans quelque pays que ce soit ; chaque nation trouvera ici les raisons de ses maximes. Si je pouvais faire en sorte que tout le monde ait de nouvelles raisons pour aimer ses devoirs, son prince, sa patrie, ses lois ; qu'on pût mieux sentir son bonheur dans chaque pays, dans chaque gouvernement, dans chaque poste où l'on se trouve, je me croirais le plus heureux des mortels. »
Dans cet ouvrage, qui a exercé sur son siècle une si grande influence, Montesquieu rend un grand hommage au christianisme, source de toute vraie félicité dans ce monde et dans l'autre. « Chose admirable, dit-il, la religion chrétienne, qui semble n'avoir d'objet que la félicité de l'autre vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci. » Il flétrit avec une véritable éloquence le fanatisme, l'intolérance et les crimes de l'inquisition. — En fait de gouvernement, il accepte tous les régimes. « Le gouvernement le plus conforme à la nature est celui qui se rapporte le mieux à la disposition du peuple pour lequel il est établi. » Mais il ne cache pas que celui qui lui inspire le plus de sympathie est le gouvernement de l'Angleterre. Il avait assez séjourné dans ce pays pour en apprécier l'admirable constitution, qu'il a le premier fait comprendre à l'Europe et qu'il a fait envier.
Le livre de L’Esprit des Lois a donné lieu à bien des critiques, « Peu de livres, nous dit M. Villemain, ont été plus contredits que L’Esprit des Lois, pour l'ensemble et pour les détails. On y a relevé des divisions arbitraires, de fausses conséquences de faits. Et cependant, malgré ces attaques, le monument n'a rien perdu de son prix et subsiste tout entier. C'est qu'il a le mérite d'être surtout historique ; c'est que les vues générales en sont vives et justes, et qu'il n'a guère que des erreurs partielles ; ce qui, dans les ouvrages de génie, ne compte pas plus que les fractions dans un grand calcul. »
On a critiqué la forme de ce livre, que l'on trouve trop spirituel pour des matières si graves. On cite de Mme Du Deffant un mot qui fit fortune : « Ce n'est pas l'esprit des lois, dit-elle, mais de l'esprit sur les lois. » Il y a, en effet, infiniment d'esprit, quelquefois même de la recherche dans le style, mais cela ne doit pas nous empêcher d'admirer la profonde science, les idées neuves, le génie et l'éloquence qui y dominent.
Montesquieu occupe, avec Racine, la première place parmi nos grands écrivains ; son style est, comme son sujet, grand et noble ; il est de plus, concis, énergique, précis, souvent fin et plein de grâce.
SENTENCES DÉTACHÉES
Quand ou court après l'esprit on attrape la sottise.
Une belle action est celle qui a de la bonté, et qui demande de la force pour la faire.
La raillerie est un discours en faveur de son esprit contre son bon naturel.
Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous.
Chose admirable, la religion chrétienne qui ne semble avoir d'objet que la félicité de l'autre vie fait encore notre bonheur dans celle-ci.
Aimer à lire, c'est faire un échange des heures d'ennui que l'on doit avoir en sa vie, contre des heures délicieuses.
(1) Ce nom est dérivé de l'espèce de bonnet de velours noir galonné d'or, en forme de mortier, que les présidents de parlement portaient aux jours de cérémonie, comme marque de leur dignité.
Daniel Bonnefon, Les écrivains célèbres de la France, ou Histoire de la littérature française depuis l'origine de la langue jusqu'au XIXe siècle (7e éd.), 1895, Paris, Librairie Fischbacher.
